Lecture analytique du tableau II
[NOTES]
Suite du tableau précédent. En fait entre les 2, ils ont mangé (« il les aurait reconnu depuis ce matin », p. 39), ils sont en train de prendre le café (« renversé sa tasse », p. 34)
Pourquoi ce brutal et étonnant changement de point de vue ?
1. Cinq personnages, un langage, une microsociété
La cuisinière
La première à parler.
Plus âgée que le couple Juliette-VdC
N'apparaîtra jamais dans les tableaux « des maîtres »
Le chauffeur
Le second à parler
Duo avec la cuisinière. Sont-ils mariés ? Ils ne communiquent pas avec les autres, sauf un peu avec le MdH (« M'sieur Jules »).
N'apparaîtra jamais dans les tableaux « des maîtres »
Juliette
Centrale. Enjeu (la jalousie de son mari & les autres qui « rigolent »)
Prénom d'amoureuse.
Mais dégradée : Jacques, le facteur (contradiction : somnifères & précipitation [courrier renversé]), y en-a-t-il d'autres ? (rire des 3 autres)
Le valet de chambre
Mari de Juliette - Jaloux.
Le seul à n'avoir pas connu Jacques (p. 36).
Plus jeune que Jacques (p. 38)
Le maître d'hôtel (Monsieur Jules)
Le seul avec Juliette à avoir un nom.
Le langage du peuple
Familier
- « Ça bardait » (p. 35)
- « Chercher des pouilles aux mots » (p. 35)
- « cocu » (p. 35)
- « sa sale gueule » (p. 36)
- « casser la gueule » (p. 37)
- Syntaxe (« jusqu'à des quatre heures du matin » (p. 36)
- Renforcement des marques de l'énonciation (toi, tu... moi, je, p. 36)
- Même les didascalies (« Les autres rigolent »).
- etc.
Grossier
- « Ce petit salaud-là » (p. 36)
Erreurs de langage
- « leur “mnésie” » [la mnésie] (p. 39)
Mais aussi truculence
- Dialogue clos par « C'est quelque chose d'être mort ! /Et d'être cocu, donc ! »
Le Maître d'Hôtel entre les deux
Parle bien, de manière assez relevée, mais « rigole » avec la cuisinière et le chauffeur.
Une micro société
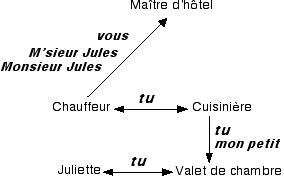 |
Schéma 1 : Qui s'adresse à qui et comment.
Hiérarchie
Avec ses histoires/problèmes (Juliette infidèle,...)
Question d'ordre « économique » : ces gens ne jouent aucun rôle dans l'intrigue (sauf un peu juliette, et encore). Une d'entre elles ne réapparaîtra jamais plus. Pourquoi Anouoilh s'est-il donné la peine de les dessiner de manière assez nette ? Paradoxe.
Premières réponses
- Recherche comique
- C'est eux qui vont donner les [presque] premières informations sur Jacques
2. Informations et confirmations
« Un vrai petit salaud »
Diverses histoires répétitives
- goujaterie (« me faire poireauter jusqu'à des quatre heures du matin [...] quand tu étais gelé »)
- ivrognerie jusqu'à la maladie
- brutalité à l'égard des domestiques, et en particulier du marmiton
- doute sur ses rapports avec Juliette (le facteur, ton vrai premier ?)
« quand il a levé la main sur Madame »
Pas racontée, mais l'on peut imaginer
Annonce de tableau III (racontée par la mère)
« L'histoire avec le fils Grandchamp »
Pas racontée (en tout cas elle a marqué pour ressortir 18 ans plustard)
Annonce de tableau III (racontée par la mère & Juliette)
« L'histoire Valentine »
Absence de la préposition
Tient la place la plus importante. La seule à être évoquée plusieurs fois (p. 34-35, 37, 39, 40)
On la connaît déjà sans en avoir les détails (ceux que le MdH prétend connaître)
Il a pris pour maîtresse la femme de son frère.
« L'histoire des cinq cents mille balles »
Pas racontée mais l'on imagine (vol)
Annonce de tableau III (par Valentine)
« Toutes celles que nous ne connaissons pas »
Point d'orgue
3. Le jeu des regards
 |
Schéma 2 : le jeu des regards
La serrure
- La cuisinière première à la serrure.
- Le chauffeur lui succède à la serrure et y revient ensuite après Juliette
- Juliette
- Le maître d'hôtel ensuite (sa dignité)
- Le valet de chambre (à la fin & uniquement pour donner l'ordre de "repli")
= Presque ordre de prise de parole
D'ailleurs être à la serrure est un enjeu (didascalie récurrente, « Attends »)
Dans un premier temps l'objet définit surtout un espace (première didascalie)
Complexité du jeu des regards.
Le regard va être central dans cette histoire.
Enchassements
Jeux de miroir
Le jeu des paroles est simple, mais il cache une vérité complexe révélée par le jeu des regards.
Le jeu des savoirs
Qui sait quoi ? Personne ne sait tout.
- Mme R ne connaît pas l'histoire de Valentine
- La cuisinière ne connaît pas le geste envers la mère
Rôles de ce contrechamp
La société des valets reflets de celle des maîtres
Les sociétés sont bien identiques. Les différences ne sont qu'extérieures.
- Mêmes préjugés
- « Les histoires des maîtres sont les histoires des maîtres » (p. 37)
- « si ce gars-là c'était sa famille, il les aurait reconnus depuis ce matin » (p. 39) [ = Duchesse]
- les serrures du bon vieux temps (bas page 35)
- Même conformisme
- « Et pourquoi tu le défends, toi ? Tu ne peux pas faire comme les autres ? »
- Mêmes clichés romanesques
- « Un vrai beau gars. Et distingué » p. 38)
- Le couple Juliette-valet de chambre est un double inversé du couple Jacques-Valentine (ils sont regardés avec la même ironie par les 3 autres domestiques : « Si c'est comme ça qu'il les aime, M'sieur Jules », p. 39)
Chœur dans les tragédies antiques
Alternance avec scènes de confrontation entre les personnages - MdH coryphée.
Transforme l'identité en destin
- « C'est lui ! c'est lui ! Je reconnais sa sale gueule à ce petite salaud-là » (p. 36)
- « Ah ! c'est lui, c'est lui, j'en suis sûre... » (p. 38)
- « Mais pour être lui, c'est lui. J'y parierais ma tête. » (p. 40)
Or eux n'ont aucun intérêt à le reconnaître.
La conclusion, c'est le MdH qui la donne et elle est tragique : « Les vies commencées comme ça ne se terminent jamais bien. »
Mesurer la distance parcourue depuis l'entrée ridicule de la duchesse Dupont-Dufort jusqu'à cette dernière réplique.
Mais la scène se termine sur la jalousie ridicule du VdC. Retour à la légèreté et l'ironie.
Conclusion
Poursuite de la scène d'introduction/d'exposition. Très longue exposition.
On continue à apprendre des faits. Certains sont confirmés, d'autres annoncés
Mais le personnage de Gaston/Jacques s'assombrit.
Et la tonalité tragique se met en place, dans les mots et dans la structure même de la scène, sous l'apparence de la comédie, voire de la farce graveleuse.